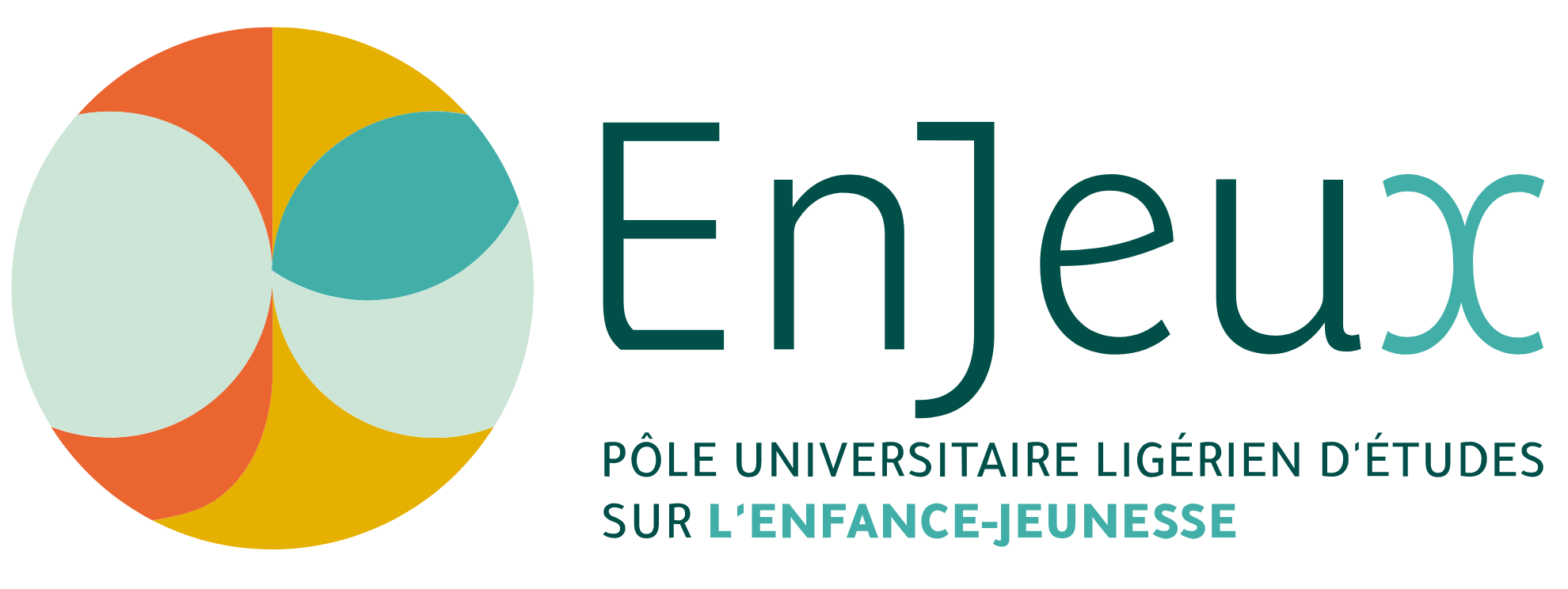Pourquoi la philosophie (avec les enfants) compte
Résumé
Je commencerai par souligner un paradoxe, le paradoxe de cette rencontre qui peut paraître absolument improbable entre le monde de la philosophie et le monde de l'enfance. La philosophie, comme discipline scolaire, n'est enseignée quasiment partout dans le monde qu’au lycée ou qu’à l’université – c’est-à-dire justement quand on sort de l’enfance. En France par exemple, la discipline n’est enseignée qu’une seule année en Terminale dans les lycées généraux et technologiques mais pas professionnels – ce qui exclut de fait l’immense majorité de enfants des classes populaires (sociologiquement orientés dans cette filière). Ainsi, nos systèmes éducatifs sont à la fois fondés et nourrissent une représentation tardive et élitiste de l’exercice philosophique.
Pourtant, les très jeunes enfants (dès 4/5 ans) sont dans une expérience philosophique originelle et fondamentale : celles de « l'étonnement devant le monde ». Aristote disait que ce qui distingue les Humains des autres animaux, c’est justement cette capacité à s’étonner devant le monde (l’âge des « pourquoi ? », des « comment ? »). Il n'y a donc pas d'âge pour se poser des questions philosophiques (comme le soulignaient aussi déjà Épicure ou Montaigne) et commencer ce chemin intellectuel, existentiel pour tenter de donner sens à son expérience du monde. La philosophie avec les enfants s’appuie donc d’abord sur un certain regard sur l’enfance, sur un postulat éthique, anthropologique d’une certaine définition de l’enfant comme « sujet », comme personne « à part entière ».
En plus de cet enjeu éthique de reconnaissance, la philosophie avec les enfants s’appuie aussi sur des enjeux profondément politiques et en particulier sur un enjeu d’émancipation.
Fichier principal
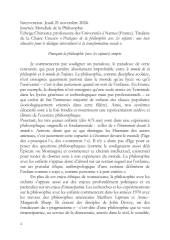 Edwige CHIROUTER. TEXTE JOURNÉE MONDIALE DE LA PHILOSOPHIE.pdf (123.14 Ko)
Télécharger le fichier
Edwige CHIROUTER. TEXTE JOURNÉE MONDIALE DE LA PHILOSOPHIE.pdf (123.14 Ko)
Télécharger le fichier
| Origine | Fichiers produits par l'(les) auteur(s) |
|---|